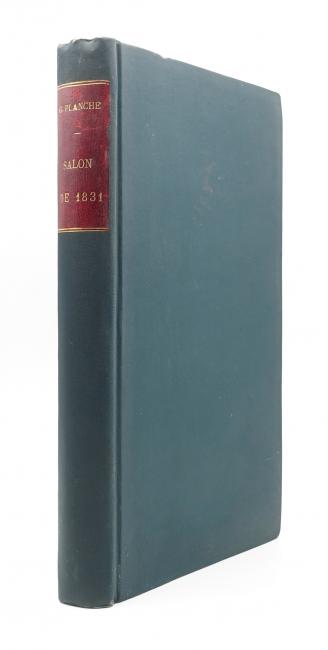Premier ouvrage du sévère Gustave Planche, ce Salon est aussi le meilleur, et marque une date dans la critique d’art.
Le pontife pérorant et conservateur qu’il deviendra sous le Second Empire est encore loin. C’est le jeune républicain, qui se lance, à 23 ans, dans une défense et illustration de l’école romantique en se réclamant dès l’Introduction des bouleversements politiques induits par la révolution de 1830. Il inaugure un nouveau genre de critique, réfléchie et distanciée, énonçant les principes philosophiques qui la sous-tendent, et dont la revue L’Artiste soulignera la singularité.
Planche a dû emprunter de l’argent à un ami architecte, Robelin, pour financer l’ouvrage – paru d’abord en livraisons, comme souvent à l’époque – qu’il rédige de mai à août 1831 tout en quêtant désespérément d’autres commandes journalistiques, pour ne pas mourir de faim. D’autres amis qui ont pour nom Delacroix, Boulanger, Isabey, les sculpteurs Barye, Antonin Moine, etc, l’autorisent à faire reproduire par Porret une gravure d’une de leurs œuvres.
Parmi elles, La Liberté de Delacroix figure en bonne place : un tableau que Planche est le seul, à l’époque, à considérer comme le meilleur du Salon. Sa nouveauté est, pour lui, la marque de la capacité de Delacroix à se renouveler, qui fait sa grandeur, par opposition à ceux qui ne font qu’exploiter les procédés des étapes précédentes du romantisme. Il est caustique vis-à-vis de ces suiveurs, Delaroche, Dubuffe, Léopold Robert, qui sont les hommes à la mode et leur oppose ceux qu’il tient pour les vrais artistes de l’avenir : Delacroix, Decamps, Barye.
Coup de maître, ce coup d’essai de Planche sera un four éditorial : le ton était trop sérieux par rapport à la moyenne des revuistes.
Ex-libris Pierre Munier.